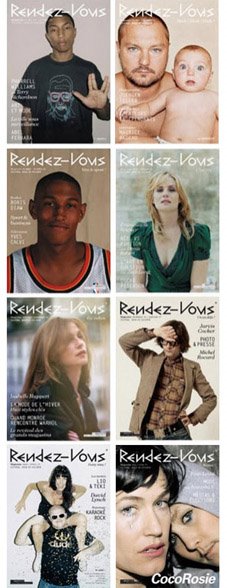•• RdV#9 •• Analyse •• Par Antoine Couder. Photo Alain Declercq.
•• RdV#9 •• Analyse •• Par Antoine Couder. Photo Alain Declercq.C’est encore un petit groupe d’irréductibles qui, pour l’instant, ont préféré rester anonymes, et pour qui la victoire de Nicolas Sarkozy sonne le glas d’un bien beau vivre ensemble. Récit imaginaire d’une longue veillée funèbre.
Ils sont sonnés, depuis le dimanche noir de l’élection présidentielle. Ils hésitent entre revisiter le site d’Arte qui parodie à loisir la rhétorique de Nicolas Sarkozy (mais pour combien de temps encore, s’inquiètent-ils) et se replonger dans la lecture de La Résistible Ascension d’Arturo Ui, une pièce de Bertolt Brecht qui raconte comment un minable gangster prend le pouvoir à Chicago sous prétexte de protéger un mystérieux trust des choux-fleurs. Ils caressent alors le projet de créer un Front de libération du chou-fleur. L’idée leur arrache un sourire. Mais ils n’ont pas le cœur léger tant ils sont occupés à enterrer définitivement cette gauche de gouvernement qui se révèle incapable d’assurer une alternative crédible, et qui emporte avec elle l’idée qu’ils se faisaient du XXe siècle, c’est-à-dire une combinaison réussie de la croissance et de la solidarité qui produirait de la culture. Les voilà donc sidérés devant cet écroulement, cette façon de remplacer Jeanne Moreau par Jean-Marie Bigard, de menacer de supprimer purement et simplement le ministère de la Culture ou de travailler au corps le contrat de travail à durée indéterminée.
Est-ce que tu es sérieux ?
« Mourir ou changer », écrivait Zaki Laïdi, à propos de la nécessité pour le Parti socialiste de se rénover (1). Or, changer, il n’en est pas question. Les voici donc prêts à mourir en leur pauvre cœur, dans le silence, l’aversion (du latin aversio), le simple « regard détourné » ; dans ce soi-disant respect de l’adversaire dont Ségolène Royal avait tenté bien en vain de se faire la messagère. Bien sûr, ils sont en colère, mais sans doute le sont-ils autant contre elle que contre lui. Le gâchis, la terrible vérité des urnes, les peines fermes et définitives qui clôturent la tentative de jouer à Counter-Strike en direct, dans les rues des grandes villes (2). À quoi auront donc servi tous ces rapports officiels soulignant le caractère pathogène de l’incarcération des plus jeunes ? À rien, sinon à charger encore la liste de ce à quoi il faut dire adieu maintenant : au fait de croire à une certaine légèreté et peut-être même à l’existence d’un second degré, à l’idée que l’on n’est pas sérieux quand on a dix-sept ans, au fait que l’on n’est pas majeur pénal à seize ans, ou encore, qu’il existe ce que l’on appelle une Protection judiciaire de la jeunesse.
« De tout mon cœur d’enfant »
La ville se referme et la classe dangereuse est renvoyée au lourd devoir d’héroïsme, à la mort tragique d’un Guy Môquet dont on a extrait la substance communiste pour ob-tenir un concentré de compassion. « Je vais mourir, écrit-il dans une lettre à sa mère… Ce que je te demande, ce que je veux que tu me promettes, c’est d’être courageuse et de surmonter ta peine… Je vous quitte tous, toutes… en vous embrassant de tout mon cœur d’enfant. Courage ! » (3) Une lettre que l’on peut lire dans la station de métro qui porte le nom du jeune homme et qui sera dorénavant lue chaque année aux élèves de l’Éducation nationale, à l’occasion de la rentrée scolaire (4). Commence alors ce drôle de deuil rendu clandestin par la loi inflexible de la majorité. Comment le peuple a-t-il pu à ce point se tromper sinon justement parce qu’on l’a trompé en beauté, usant d’images et de propositions qui troublent ses facultés. Dans chaque déclaration du président leur apparaît alors le signe du mensonge, le venin de la communication, cette « imitation de la réalité » dont parlait Socrate lorsqu’il s’agaçait de la suprématie de la peinture sur la pensée. « Tu as atteint ton but. Assoiffé de revanche, tu as vaincu tes démons intérieurs pour trouver la force de tuer le dieu de la guerre et t’approprier son trône. Mais trop longtemps tu as vécu dans l’ombre des autres dieux : il est temps d’en finir. » (5)
La culture du « hein ? Quoi ? »
Et cela commence par la nomination de Bernard Kouchner au poste de ministre des Affaires étrangères, geste extrême qui vient brouiller les cartes des valeurs et confirmer la liquidation de mai 68. D’un côté, il n’y a qu’une France, il n’y a qu’une sorte d’intérêt… Il n’y a donc plus à hésiter ; comme l’écrit The Economist, « à quoi sert-il de voter à gauche puisque la gauche est déjà au gouvernement » (6) ? Ensemble, tout devient possible. Voilà un slogan qui n’a pas été suffisamment analysé. Ce qui devient possible, c’est donc un brouillage général, comme si nous entrions aujourd’hui dans la culture du « hein ? Quoi ? ». Un brouillage qui s’étend sur la moindre parcelle de réalité. Partout, la règle simple est contestée, la jurisprudence rediscutée. « Je ne vois pas pourquoi », comme dit le président… C’est ainsi que l’état d’exception finit par devenir la règle, en France comme aux États-Unis. « Hein ? Quoi ? ». La vie politique s’installe dans une tension permanente entre la demande de procédure démocratique et un pouvoir exceptionnel qui se développe et se concentre entre les mains de l’exécutif. Et même s’il faut être bien mal informé pour croire qu’un média peut verrouiller l’opinion, il faut sans doute être très malin pour faire passer un « message ». Il faut s’appeler Eva Joly pour se permettre de dire que le problème français en matière de corruption des élites, c’est en grande partie une « allégeance au président de la République » (7), une soumission féodale au chef tout-puissant, seule véritable garantie de protection. D’ailleurs, regardez comme nous pouvons être indulgents avec Jacques Chirac. Regardez comment le nom de Jean Tiberi inscrit sur la liste des élus de la République ne nous fait pas sursauter. Car, évidemment, « tout se tient », comme disait « l’autre » (8) : il n’y aura effectivement aucune amnistie présidentielle pour les infractions au code de la route, mais il sera toujours bien compliqué d’y voir plus clair dans l’affaire Clearstream.
Do not opensource la Résistance
« Hein ? Quoi ? », ce serait vraiment le super gimmick du Front de libération des choux-fleurs si d’aventure, le groupe consentait à s’organiser. En attendant, il faut être très vieux et vivre loin de Paris pour alpaguer le président de la République à l’antenne de France Inter et affirmer qu’on lui refuse le droit d’« opensourcer » l’idée de Résistance, en transformant sa balade sentimentale sur le plateau des Glières en une communion avec l’Histoire (9). Il faut être un vieux résistant grognon, spectre vivant de la mémoire qui s’efface, pour dénier au jeune élu suprême le droit de faire le tri entre le gaullisme et les ordonnances de 1945, les « compagnons de la Libération (plutôt de droite) » et le Conseil national de la Résistance (qui comptait notamment des communistes). Ce pack français, ce socle constitutionnel qui, jusqu’ici, nous tenait ensemble et qui semble aujourd’hui menacé pour cause de « rupture ». De cette rupture, de cette séparation, on voudrait encore pouvoir discuter. Et, pour commencer, répéter ces mots entendus par hasard, au détour d’une Histoire(s) du cinéma : « … Il disait que la fidélité si grande soit-elle est sans effet sur la marche du temps, qu’elle n’est susceptible de rien ressusciter, ni personne, et que néanmoins, il n’est d’autre solution que la fidélité »10. Une bien belle façon de se dire adieu.
(1) In Libération, 8 mai 2007. (2) Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, le bilan des trois jours d’émeutes post-élection est de 80 policiers et gendarmes blessés, 2 000 voitures brûlées et 887 interpellations. (3) Mais il y a mieux encore dans le genre, par exemple : « Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège, ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi et même, ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé. » Hommage d’André Malraux à Jean Moulin, décembre 1964. (4) C’est la première décision présidentielle de Nicolas Sarkozy afin de faire prendre conscience aux jeunes collégiens français de ce qu’est l’amour de la France, « un amour qui peut et qui a souvent conduit au sacrifice », comme il dit. (5) Puisque la culture est aujourd’hui en voie de dilution dans le monde du divertissement, il est sans doute difficile pour le non-spécialiste de faire la différence entre un texte classique et cette baseline publicitaire du nouveau jeu sur Playstation 2, God of War, « L’origine de la fin ». (6) The Economist, 26 mai 2007, article « The Kouchner Effect ». (7) In La force qui nous manque, par Eva Joly (avec Judith Perrignon), éditions Les Arènes , mai 2007. (8) Ségolène, bien sûr. (9) « Créer, c’est résister, résister, c’est créer », Là-bas si j’y suis , Daniel Mermet, 24 mai 2005, suite à la visite du candidat Sarkozy venu rendre hommage à ceux qui, ici, sont morts pour la patrie. (10) Histoire(s) du cinéma, Jean-Luc Godard, ECM Series, 1998.